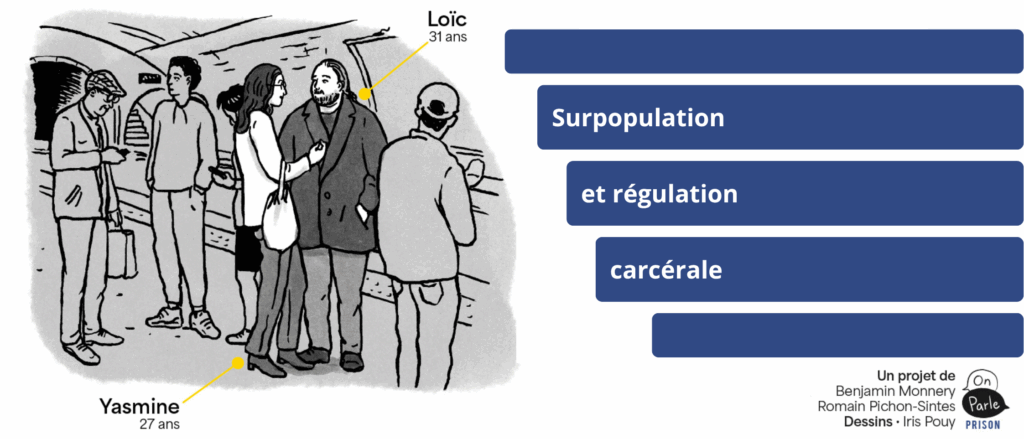La surpopulation carcérale : un problème ancien, des solutions urgentes
La surpopulation des prisons françaises est un problème chronique bien connu, particulièrement dans les Maisons d’Arrêt où le taux de surpopulation dépasse en 2025 les 160 %. La surpopulation dégrade considérablement les conditions de vie des détenus, souvent entassés à 2 ou 3 dans 9 mètres carrés et avec un accès réduit aux activités ; elle rend aussi le travail des surveillants plus difficile, risqué et ingrat, les réduisant souvent à un rôle de porte-clés gérant des flux.
Parce qu’elle impacte et conditionne tous les pans de la vie carcérale, la surpopulation est au cœur des réflexions sur la prison depuis au moins deux décennies. Mais les acteurs du système pénal échouent collectivement à résorber ce problème structurel : entre janvier 1990 et janvier 2020, le parc pénitentiaire a gagné environ 25 000 places, mais la population carcérale a elle aussi augmenté de 25 000 détenus, laissant le problème de surpopulation inchangé.
Aujourd’hui, face à l’extrême urgence de la situation et après les échecs d’approches alternatives, la seule solution à court-terme semble résider dans un mécanisme de régulation carcérale.
- Densité carcérale, surpopulation, surnombre
- La densité carcérale selon le type d’établissement
- L’évolution du nombre de détenus dans les prisons, grandes et petites
- Les conséquences de la surpopulation carcérale
- La question de l’encellulement individuel
- Codétenus et récidive : des effets criminogènes à ne pas négliger
- Quelle solution ? La nécessité d’une régulation carcérale
- Pour aller plus loin
Densité carcérale, surpopulation, surnombre
La densité carcérale correspond au nombre de détenus d’un établissement rapporté à sa capacité opérationnelle (telle qu’estimée par l’administration pénitentiaire à partir du nombre de cellules et de mètres carrés).
Début 2025, sur l’ensemble des prisons françaises, la densité dépasse le taux de 130 % – une situation de surpopulation carcérale – ce qui implique qu’en moyenne, 130 détenus s’entassent dans des espaces prévus pour 100 personnes. Mais en ne considérant que les quartiers surpeuplés, la densité moyenne atteint 160 % au 1er juin 2025.
Ces chiffres ont d’ailleurs tendance à minorer la gravité du problème de surpopulation au niveau national puisque certains établissements fonctionnent en sous-capacité (toutes les places ne sont pas occupées) si bien que la surpopulation se concentre de manière d’autant plus brutale dans les autres établissements. En prenant en compte ces places non-utilisées (on en compte actuellement près de 2 000), on obtient un nombre de détenus en surnombre de l’ordre de 23 000 détenus au 1er juin 2025.
La surpopulation est devenue un phénomène plus que courant pour les détenus. Actuellement, 73 % des détenus vivent dans un quartier surpeuplé. En plus de s’intensifier, la surpopulation s’impose progressivement comme une situation de référence pour les détenus, comme permet de l’observer le graphique ci-contre.
La densité carcérale selon le type d’établissement
La surpopulation carcérale peut être analysée à l’échelle de chaque prison selon le type d’établissement (voir les définitions sur notre page dédiée) comme le fait le graphique ci-dessous, en se basant sur les données de la décennie 2014-2024.
- La surpopulation carcérale est loin d’être un phénomène marginal. C’est même un phénomène très majoritaire dans les Centres Pénitentiaires (CP) et plus encore dans les Maisons d’Arrêt (MA) et quartiers Maison d’Arrêt.
- Ce sont les Maisons d’Arrêt qui présentent la densité moyenne la plus élevée. Au sein même de ce type d’établissement pénitentiaire, la variation entre les établissements est très importante, comme en témoigne le profil très allongé du graphique ci-contre. Les Centres Pénitentiaires sont aussi touchés par le phénomène de surpopulation carcérale. Ce n’est généralement pas le cas des Centres de Détention (CD), Maisons Centrales (MC), Centres de Semi-Liberté (CSL) et Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM). Ces établissements pour peine fonctionnent en effet en pratique sous une règle de numerus clausus (pas plus de détenus que de places disponibles).
- En effet, il faut faire attention aux chiffres affichés par l’Administration pour les Centres pénitentiaires, qui sont biaisés par la différence de densité des quartiers les composant. Les quartiers CD, MC, CSL et EPM tirent à la baisse le chiffre de surpopulation carcérale car ils sont très peu surpeuplés contrairement aux établissements ou quartiers MA. Ainsi, dans le Centre Pénitentiaire de Laval le taux d’occupation passe de 193 % à 263 % lorsqu’on enlève le quartier de semi-liberté ; à Chambéry, de 168 % à 213 % ; à Lons-le-Saunier, de 203 % à 281 % ; …
Découvrez les enjeux de la surpopulation et de la régulation carcérale de façon interactive et illustrée, en suivant Loïc et Yasmine dans notre épisode dédié de « On Parle Prison » !
L’évolution du nombre de détenus dans les prisons, grandes et petites
Globalement, l’évolution de la population carcérale est nettement à la hausse sur la décennie, en particulier depuis le choc du Covid-19 (voir notre page dédiée). Le graphique ci-dessous montre l’évolution du nombre de détenus dans certaines des plus grandes, mais aussi des plus petites, prisons françaises.
- Plusieurs Maisons d’arrêt et Centres Pénitentiaires hébergent régulièrement plus de 1 000 détenus, comme La Santé à Paris ou Aix-Luynes. L’établissement le plus peuplé est de loin Fleury-Mérogis (de l’ordre de 4 000 détenus).
- D’autre part, certains établissements accueillent très peu de détenus comme les établissements pénitentiaires pour mineurs ou certains centres de semi-liberté. Quelques maisons d’arrêt, très anciennes et/ou situées en outre-mer, peuvent aussi accueillir un nombre limité de détenus.
Les conséquences de la surpopulation carcérale
Les conséquences les plus directes
Les conséquences de la surpopulation carcérale sont multiples : elle dégrade directement les conditions de détention des prisonniers et détériore nettement les conditions de travail des personnels. La revue Dedans Dehors de l’OIP y consacre d’ailleurs un dossier récent (« Surpopulation carcérale : les personnes détenues prennent la parole »).
Pour les détenus
« Avec la surpopulation, il y a un bruit incroyable quand on veut dormir ; ça crie toute la nuit, ça frappe aux portes, de la musique partout, […] tout le monde est sous tension ; ça crée des bagarres, des insultes entre détenus et surveillants. » – P.A.
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 23
- Promiscuité à l’intérieur des cellules (9 m2 en général) occupées par 2 voire 3 détenus, alors qu’elles sont généralement conçues pour un seul détenu, et avec un nombre croissant de matelas au sol occupant l’espace (5 000 matelas début 2025)
- Incidents plus fréquents entre codétenus du fait du manque d’espace et de la nécessité de cohabiter avec d’autres détenus qui n’ont pas le même profil et les mêmes habitudes (fumeur ou non, amateur ou non de musique, etc.)
- Moindres possibilités d’accéder aux parloirs, aux douches, aux activités en dehors de la cellule (sport, travail, activités culturelles, etc.), et donc augmentation du temps « oisif » reclus en cellule
- Moins bon accompagnement par les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation (préparation à la sortie, aménagement de peine…) et les soignants (traitement des maladies somatiques, des addictions, etc.)
Pour les surveillants
« Avec 82 000 détenus, plus personne n’arrive à gérer dans les établissements. Tout au long, on souffre, et ça crée beaucoup de tensions. Même les surveillants deviennent fous, ils me disent : « Je vais arrêter ! » C’est incroyable. » – P.A
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 27
- Charge de travail plus élevée, d’autant que les effectifs de surveillants sont calculés sur le nombre de places et non le nombre réel de détenus. En cas de surpopulation, un surveillant est parfois en charge de plus de 100 détenus dans son aile, ce qui réduit le temps à consacrer à chaque détenu
- Risque d’agression plus élevé compte tenu du nombre de détenus par cellule, des temps d’attente plus longs et des tensions plus grandes entre codétenus
- Perte de sens avec un rôle croissant de « porte-clés » au détriment de l’échange humain et de l’accompagnement des parcours de peine
- Déficit d’attractivité du métier, qui peine à recruter de nouveaux agents et où les arrêts de travail sont particulièrement nombreux (près de 10 % de postes vacants)
D’autres conséquences importantes mais moins visibles
La surpopulation expose aussi l’Etat français à des condamnations désormais fréquentes (près de 50 établissements sanctionnés, voir la liste) de la part de la justice administrative française et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (sur le fondement de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour traitements inhumains ou dégradants). Ces condamnations sont infâmantes pour nos institutions en plus d’être couteuses, puisqu’elles impliquent des sanctions pécuniaires contre l’Etat au profit des détenus plaignants.
« De défaut de permis en multi-récidive, ce ne sont plus des arrivants que nous avons mais des revenants, toujours en attente d’un retour, aux très courtes peines, qui ne viennent pas apprendre mais se détruire, ou s’instruire au contraire pour devenir de meilleurs voyous. » – J.F.
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 17
Surtout, la surpopulation rend caduque l’essentiel des efforts en matière de réinsertion et de prévention de la récidive à la sortie. Plusieurs études françaises et étrangères suggèrent un effet néfaste de la surpopulation sur la récidive qui peut s’expliquer d’au moins deux manières : d’abord car des conditions de détention dégradées sont en soi génératrices de récidive ; et aussi car la surpopulation implique plus d’interactions sociales criminogènes avec les autres codétenus en prison (voir la section Codétenus et récidive). Ainsi, la surpopulation d’aujourd’hui peut générer la récidive de demain, alimentant un cercle vicieux.
Un bénéfice inattendu du Covid-19
Conséquence inattendue pendant le Covid-19 : alors que la population carcérale baissait très rapidement au printemps 2020 pour s’adapter au Covid-19 (voir la page Le choc du Covid-19), cette « sous-population » temporaire a été vécue comme un bol d’air par beaucoup d’agents pénitentiaires, qui ont retrouvé du sens à leur travail (plus de temps pour échanger avec les détenus et régler les problèmes, moins de tensions et d’incidents, etc.).
Ce sentiment est confirmé par l’analyse statistique des incidents (menaces, violences, trafics, etc.) et des sanctions disciplinaires relevés par l’Administration pénitentiaire en 2020, par rapport à l’année 2019.
« J’ai toujours dit au supérieur qu’il y avait trop de monde et je le vois, les surveillants doivent être partout. Il y en a quatre qui sont très gentils, humains, mais ils sont débordés et souvent des gardiens ou gradés craquent, insultent les détenus ou menacent de les gifler. » – K.L.
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 27
Comme le montre le graphique ci-contre, l’année 2020 marque en effet pour la plupart des établissements pénitentiaires une nette baisse du nombre moyen de compte-rendu d’incidents (CRI) par détenu, témoignant d’une amélioration du climat général en détention.
Surtout, les prisons qui ont vu leurs effectifs de détenus baisser particulièrement en 2020 ont aussi connu une baisse plus que proportionnelle des incidents constatés par les surveillants et des sanctions prononcées par les chefs d’établissement.
À l’échelle des prisons françaises, il existe ainsi un lien très significatif entre baisse de la population détenue pendant l’année 2020 et baisse de la fréquence des incidents (CRI) par détenu. Cette corrélation positive se retrouve aussi pour le nombre de faits jugés en commission de discipline et du nombre de sanctions prononcées (tableau ci-contre).
Le coefficient de régression étant globalement proche de 1, cela indique qu’une baisse de 10 % du nombre de détenus est associée en moyenne à une baisse de 10 % de la fréquence des incidents par détenu.
Ces résultats témoignent d’une nette amélioration du climat général en détention grâce à la baisse de la population carcérale observée pendant l’épidémie de Covid-19.
La question de l’encellulement individuel
La répartition du nombre de détenus par cellule selon le type d’établissement pénitentiaire démontre une nouvelle fois que les maisons d’arrêt sont les plus affectées par la surpopulation au sein même de la cellule. L’encellulement individuel est rare en maison d’arrêt, ainsi qu’en centre pénitentiaire. En centre de détention, en maison centrale, ou encore en établissement pénitentiaire pour mineurs, il apparait comme la règle.
Il convient toutefois de nuancer le propos. Si le fait d’être deux, trois et parfois plus au sein d’une même cellule à l’espace réduit peut être particulièrement néfaste aux conditions de vie des détenus, le fait de partager une cellule avec un codétenu peut aussi prévenir l’isolement et d’éventuels comportements suicidaires.
« Mes voisins « blancs », bien élevés, bien sous tous rapports, pleins de préjugés sur les prisonniers, du genre « Ils sont au Club Med les détenus, nos parents sont moins bien traités… » [Leur] petit dernier a atterri ici pour différents délits. Aujourd’hui [ma voisine] pleure à chaque parloir et s’engueule avec le surveillant : « Comment on peut laisser ainsi des êtres humains ? » » – F.F.
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 16
Le graphique ci-dessus montre qu’une corrélation positive existe bien entre la densité carcérale et le nombre moyen de détenus par cellule en 2020. Plus la densité carcérale est élevée, plus le nombre moyen de détenus par cellule est élevée. Les deux variables ont en effet le même numérateur (le nombre de détenus en 2020) et des dénominateurs très corrélés (le nombre de cellules et la capacité théorique de l’établissement).
Cependant, lorsque le graphique projette uniquement les maisons d’arrêt, la corrélation est beaucoup moins évidente. Pour un nombre moyen par cellule égal, les densités carcérales peuvent être très différentes : c’est le cas lorsqu’un établissement déclare une capacité théorique supérieure au nombre de cellule et prévoit ainsi de loger plusieurs détenus dans la même cellule : il peut alors avoir un nombre moyen par cellule élevé mais une densité carcérale autour de 100 %. La non-corrélation des deux variables pour les maisons d’arrêt rappelle également la grande diversité de ces établissements pénitentiaires.
Codétenus et récidive : des effets criminogènes à ne pas négliger
Si la question de la surpopulation et de l’encellulement individuel représentent d’abord un enjeu juridique et social (l’encellulement individuel est un droit depuis 1885 en France, même si son application est régulièrement repoussée à plus tard), la question des codétenus représente aussi un enjeu en matière de prévention de la récidive. En effet, de nombreux travaux en France et à l’étranger établissent un lien causal très clair entre le risque de récidive des sortants de prison et la composition du groupe de codétenus qu’ils ont eu à fréquenter, dans leur cellule ou plus largement au sein de la prison, pendant leur incarcération.
La littérature scientifique aborde cette question sous l’angle des effets de pairs criminogènes qui peuvent exister entre codétenus et qui entraînent, par conformisme, embrigadement ou échanges d’informations par exemple, des liens de causalité entre la récidive des uns et celle des autres sortants de prison.
Le principal enseignement de ces travaux réside dans le fait, qu’en moyenne, deux détenus incarcérés sur la même période pour des infractions similaires auront tendance à s’entraîner l’un l’autre dans des comportements de récidive pour des faits similaires.
Ces interactions criminogènes sont d’autant plus fortes que les détenus ont le même âge, partagent une longue période d’incarcération en commun, et sont condamnés pour des faits comme le trafic de stupéfiants ou les atteintes aux biens, où la collaboration en réseaux est particulièrement utile.
Ces résultats forment désormais un fort consensus scientifique. Ils sont obtenus dans des contextes variés, comme la France, la Norvège, l’Italie, les Etats-Unis… Pour plus de détails, une liste de travaux scientifiques sur le sujet apparait en bas de page.
« Chacun a un rythme différent, certains dorment la journée et vivent la nuit… […] La surpopulation m’impose d’être une autre personne, plus méchante. » – K.P.
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 21
Quelle solution ? La nécessité d’une régulation carcérale
L’échec des approches récentes
Ces dernières années, le plan d’action du Ministère de la Justice a cherché à augmenter l’offre pénitentiaire (hausse des capacités d’accueil) tout en maîtrisant la demande de prison (réduction des incarcérations et incitation aux libérations anticipées). Mais les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, bien au contraire.
1. Augmenter les capacités d’accueil
Si le Plan 15 000 annoncé en 2018 prévoyait de construire 15 000 places supplémentaires d’ici 2027 (et même 18 000 après révision des parlementaires), force est de constater que le nombre de places opérationnelles augmente très lentement. En effet, les travaux de construction prennent du retard, les budgets nécessaires ne sont pas programmés, et les rénovations rendent certains bâtiments inutilisables pendant plusieurs mois ou années.
Début 2025, les prisons françaises comptent à peine 3 000 places opérationnelles de plus que début 2018, mais elles doivent pourtant accueillir 12 000 détenus de plus !
2. Réduire les incarcérations
- Promotion des peines alternatives telles que le travail d’intérêt général, le sursis probatoire ou la surveillance électronique.
- Promotion des aménagements de peine, sous la forme d’un bracelet électronique le plus souvent. Néanmoins, seules 30 % des peines aménageables l’ont été ab initio par le tribunal en 2022 (OPEF-EXEC, janvier 2023).
3. Favoriser les libérations anticipées
- Instauration de protocoles locaux entre le siège, le parquet et l’administration pénitentiaire pour agir en cas de dépassement d’un seuil de criticité en matière de surpopulation locale.
- Mise en place d’une procédure de libération sous contrainte (LSC) aux deux tiers de la peine, soumise au juge d’application des peines mais n’exigeant pas de véritable « projet de réinsertion » de la part des détenus.
- Création d’une LSC de plein droit à trois mois de la fin de peine, à partir de janvier 2023 dans le cadre de la loi Confiance dans l’institution judiciaire.
- Cette libération anticipée, censée s’appliquer à tous les détenus condamnés à des peines inférieures ou égales à 2 ans (hors exceptions liées aux incidents en détention et à l’absence de logement), n’est pas totalement appliquée en pratique. Seuls 50 % des dossiers étudiés obtiennent bien une libération sous contrainte de la part des juges d’application des peines.
La seule solution à court terme : un mécanisme contraignant de régulation carcérale
Face à l’échec des nombreux outils promus par le ministère de la Justice et mis en place actuellement, la solution de la régulation carcérale semble s’imposer. Le principe de la régulation carcérale revient à limiter les entrées en détention, favoriser les sorties de détention, ou les deux. Une régulation des entrées (souvent appelée « numerus clausus« ) a maintes fois été critiquée à juste titre car elle reviendrait à empêcher les juges d’incarcérer rapidement certains condamnés ou prévenus alors qu’ils l’estiment nécessaire, faute de place disponible. Il semble donc nettement préférable d’opter pour une régulation par les sorties. En effet, cette dernière préserve la capacité des magistrats à incarcérer rapidement de nouvelles personnes en libérant les places nécessaires par des sorties anticipées.
Les principes et les enjeux d’un mécanisme national et contraignant de régulation carcérale sont discutés dans l’article ci-dessous publié dans la revue AJ Pénal (et republié librement ici). Le mécanisme suivrait les principes suivants :
- Seuil de densité carcérale : Lorsqu’un seuil de densité (100 %, 120 % ou même 150 %) est dépassé dans un établissement ou un quartier de détention, à chaque fois qu’un nouveau détenu est incarcéré, le détenu le plus proche de sa fin de peine est libéré, hors exceptions liées à son profil (comportement en détention, type d’infractions, etc.), sans quoi le détenu suivant est libéré à sa place.
- Un principe juste et proportionné : Ce principe a l’avantage de prendre directement en compte la réalité des conditions de détention de chaque détenu dans le parcours d’exécution de peine, comme c’est d’ailleurs déjà prévu par l’article 707 du code de procédure pénale : les condamnés subissant une détention dans des conditions très dégradées bénéficient d’une réduction proportionnée de leur peine, par rapport aux détenus incarcérés dans de meilleures conditions.
- Une sortie contrôlée et sous conditions : Les détenus bénéficiant d’une sortie anticipée par la régulation carcérale pourraient être placés pour la fin de leur peine sous le régime de la « libération sous contrainte pour surpopulation carcérale excessive », en remplacement de LSC de plein droit à 3 mois source d’injustices et d’inefficacité.
- Le principal avantage d’une libération sous contrainte de plein droit pour surpopulation carcérale par rapport à celles en vigueur est qu’elle repose sur un critère objectif (le taux d’occupation des établissements pénitentiaires), et non sur des critères subjectifs sans lien avec la détention (tels que l’absence de logement « stable » ou un risque de récidive « élevé« ) responsables de l’application très partielle de ce mécanisme. Surtout, ce nouveau type de libération sous contrainte aurait des effets concrets et très rapides sur la surpopulation carcérale.
Article publié dans AJ Pénal (Dalloz, septembre 2023) et republié en 2025 sous la forme d’un Working Paper AFED librement accessible
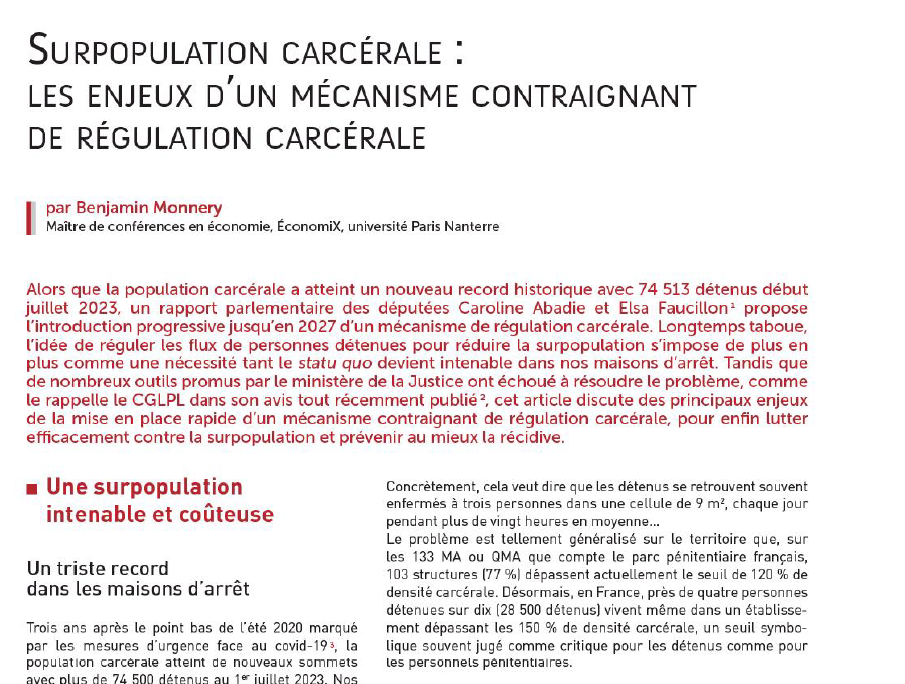
L’approche alternative et plus progressive des députées Abadie et Faucillon
Avancée dans le rapport parlementaire de juillet 2023 des députées Caroline ABADIE et Elsa FAUCILLON, le but de cette approche alternative consiste à arriver progressivement à un taux de densité carcérale maximum de 100 % dans les maisons d’arrêt d’ici le 1er juillet 2027. Cette proposition datant de 2023 prévoyait qu’un tiers du surnombre soit supprimé au 1er juillet 2025, deux tiers au 1er juillet 2026 et donc la totalité au 1er juillet 2027. Un mécanisme équivalant de libération sous contrainte aurait été mis en place, concernant les détenus condamnés à deux ans de prison au plus et dont il reste moins de 6 mois à exécuter, sous réserve que leur profil le permette.
La question de la mise en œuvre et de l’acceptabilité sociale
La mise en place d’un tel mécanisme suppose de relever deux difficultés principales : le choix du seuil de surpopulation carcérale à partir duquel se déclenche le mécanisme, et la question de son acceptabilité sociale.
1. La fixation du seuil de surpopulation
- Quel seuil ? : le seuil de densité choisi (100 %, 120 % ou même 150 % par exemple) doit refléter un certain équilibre entre le bénéfice retiré par la société de l’amélioration des conditions de détention (dignité humaine, diminution du taux de récidive, amélioration des conditions de travail des surveillants), et le coût engendré par l’érosion des peines par rapport à celles initialement prononcées par les tribunaux (perception d’injustice ou d’impunité, possible augmentation de la délinquance).
- Un seuil national ou local ? : ce seuil de surpopulation carcérale peut être choisi soit uniformément sur tout le territoire, soit dépendre des spécificités de chaque établissement ou chaque région.
- Il s’agit d’un arbitrage politique sensible qui doit être débattu et décidé collectivement. Il s’agit de déterminer le bon équilibre entre la réduction des durées d’incarcération par rapport aux peines prononcées par les juges (érosion des peines) et les bienfaits sociaux d’une baisse de la surpopulation carcérale (pour les détenus, les surveillants, etc.).
2. La question de l’acceptabilité sociale
- Selon les gardes des Sceaux successifs, les Français ne seraient pas « prêts » à une libération massive de la sorte. Pourtant plusieurs exemples laissent à penser le contraire :
- Les libertés sous contrainte de plein droit de 2023 relèvent déjà de la régulation carcérale. Même si elles ne sont pas automatiques dans les faits, et montrent des chiffres bien en-deçà de ceux attendus, la loi prévoit bien déjà qu’elles s’appliquent de plein droit à trois mois de la fin de peine.
- Les grâces collectives du 14 juillet, utilisées jusqu’en 2006, étaient le fruit d’une longue tradition (les grâces octroyées le jour d’une fête trouvent leur origine dans l’Antiquité, en atteste la libération d’un prisonnier le jour de la Pâque juive dans l’Empire romain).
- La baisse de 18 % de la population carcérale en 3 mois au moment du premier confinement de 2020, entraînant une sous-population carcérale, n’a pas engendré de contestations massives de la part de l’opinion publique. Une telle politique ne semble donc pas être si impopulaire.
- Le mécanisme de régulation carcérale comprendrait des garde-fous :
- Certains profils de détenus ne pourraient y avoir accès (terroristes, criminels, etc…)
- Les détenus libérés continueraient d’être suivis et contrôlés, dans le cadre d’un placement sous bracelet électronique ou d’une semi-liberté par exemple.
- Une forme de sursis pourrait être mis en place, comme cela a été fait en Italie en 2006 : en cas de recondamnation dans un laps de temps donné, le détenu devrait purger sa nouvelle peine mais aussi la fin de sa peine précédente. Trois chercheurs ont montré que ce rallongement de peine avait eu un effet dissuasif sur la récidive en Italie après 2006.
Quoi qu’il en soit, une mise en œuvre intelligente du mécanisme, fondée sur une coopération étroite entre l’administration pénitentiaire et le tribunal judiciaire et une préparation sérieuse de la sortie du détenu, est indispensable à sa réussite. En effet, il a été démontré en France que les sorties « surprises », non anticipées et mal préparées, peuvent avoir des effets néfastes sur la criminalité car elles génèrent un sentiment d’impunité et mettent les détenus libérés dans une situation de précarité.
Conclusion
La régulation carcérale serait la méthode la plus rapide et équitable pour réduire la surpopulation carcérale. Elle fait désormais l’objet d’un large consensus de la part des spécialistes, des professionnels, des chercheurs. De plus, elle permet d’appliquer le principe légal selon lequel chaque détenu « bénéficie […] d’un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire » (art. 707 du Code de Procédure pénale). Autrement dit, avec la mise en place de ce mécanisme, une peine moins longue dans un établissement surpeuplé équivaudrait à une peine plus longue dans un établissement qui ne l’est pas, toutes choses égales par ailleurs. Etant donné que les conditions de détention dans un établissement surpeuplé sont plus dures, cette équivalence paraît équitable.
La régulation carcérale semble donc être une solution crédible et socialement acceptable pour limiter rapidement la surpopulation carcérale dans les prisons françaises.
« Peu de temps après, ce fut à mon tour d’être choqué, en lisant les disposition du CPP qui évoquaient un ENCELLULEMENT INDIVIDUEL ! C’était la loi. Choc légitime pour un prévenu qui n’a jamais connu que la surpopulation pénale. » – H.T.
Source : OIP Dedans Dehors n°126, Avril-Mai 2025, p. 25
Pour aller plus loin
Etudes avec des données étrangères
(Floride)
BAYER, P., HJALMARSSON, R. & POZEN, D., « Building Criminal Capital behind Bars: Peer Effects in Juvenile Corrections », Quarterly Journal of Economics, vol. 124, February 2007, pp. 1-34.
Cet article analyse l’influence des mineurs délinquants purgeant une peine dans le même établissement pénitentiaire sur leurs comportements criminels ultérieurs. L’analyse s’appuie sur des données concernant plus de 8 000 personnes purgeant une peine dans 169 établissements pénitentiaires pour mineurs sur une période de deux ans en Floride. Ces données fournissent un historique complet des infractions commises, des affectations dans les établissements, ainsi que des arrestations et des jugements prononcés au cours de l’année suivant la libération de chaque individu. Afin de contrôler l’affectation non aléatoire aux établissements, les auteurs incluent des effets fixes liés à l’établissement et aux infractions antérieures, estimant ainsi les effets des pairs en utilisant uniquement les variations intra-établissement au fil du temps. Ils constatent des effets des pairs solides pour les cambriolages, les vols mineurs, les infractions graves et les délits liés aux stupéfiants, les voies de fait graves et les infractions sexuelles graves ; l’influence des pairs affecte principalement les personnes ayant déjà une certaine expérience dans une catégorie de criminalité particulière. Ils ont également constaté que les principaux types d’effets des pairs diffèrent selon qu’il s’agit d’établissements résidentiels ou non résidentiels ; les effets dans ces derniers sont cohérents avec la formation de réseaux parmi les jeunes purgeant une peine à proximité de leur domicile.
(Floride)
STEVENSON, M., « Breaking bad: Mechanisms of social influence and the path to criminality in juvenile jails », Review of Economics and Statistics, 2017, 99(5), 04/05/2017, pp. 824-838.
L’auteur a mené une série de tests d’influence des pairs dans des centres de détention pour mineurs, motivés par trois mécanismes : le transfert de compétences criminelles, la formation de nouveaux réseaux criminels et la contagion sociale de facteurs non cognitifs liés à la criminalité. En identifiant l’influence des pairs à partir de variations naturelles au sein de petites cohortes au sein d’un même établissement, il observe des preuves compatibles avec la contagion sociale : l’exposition à des pairs issus de foyers instables et présentant un niveau élevé d’agressivité entraîne une augmentation de la criminalité après la libération, ainsi qu’une augmentation des attitudes et comportements criminels. Cet effet persiste malgré le contrôle de l’expérience criminelle et de l’affiliation à un gang de la cohorte, et se retrouve dans des contextes où les jeunes sont peu susceptibles d’interagir après leur libération.
(Italie)
DRAGO, F., GALBIATI, R. & VERTOVA, P., « The deterrent effetcs of prison : evidence from a natural experiment », Journal of Political Economy, 2009, 117(2), 01/04/2009, pp. 257-280.
Le projet de loi sur la clémence collective, adopté par le Parlement italien en juillet 2006, constitue une expérience naturelle pour analyser la réponse comportementale des individus à une manipulation exogène des peines de prison. Sur la base d’un ensemble unique de données sur le comportement post-libération d’anciens détenus, les auteurs constatent qu’une réduction d’un mois de peine de prison, commuée en une augmentation d’un mois de peine prévue pour les délits futurs, réduit la probabilité de récidive de 0,16 point de pourcentage. À partir de ce résultat, ils estiment une élasticité de la récidive moyenne par rapport à la peine prévue égale à −0,74 sur une période de 7 mois.
(Italie)
DRAGO, F. & GALBIATI, R., « Indirect Effects of a Policy Altering Criminal Behavior: Evidence from the Italian Prison Experiment », American Economic Journal: Applied Economics, 2012, 4(2), pp. 199-218.
Les auteurs exploitent la grâce pénitentiaire italienne de 2006 pour évaluer l’influence des pairs sur le comportement criminel. Cette grâce commue aléatoirement les peines réelles en peines prévues pour 40 % de la population carcérale italienne. En utilisant le lieu de détention et l’origine géographique pour constituer des groupes de référence d’anciens détenus, ils constatent d’importants effets indirects de cette politique. En particulier, ils remarquent que la réduction de la récidive des individus due à une augmentation de la peine résiduelle de leurs pairs est au moins aussi importante que leur réaction à une augmentation de leur propre peine résiduelle. À partir de ce résultat, ils estiment un multiplicateur social de la criminalité égal à deux.
(Norvège)
VEDELER JOHNSEN, J. & KHOURY, L., Peer Effects in Prison, IZA DP No. 17114, July 2024.
Cet article offre une meilleure compréhension de la manière dont les effets des pairs façonnent le comportement criminel des détenus, en se concentrant sur l’impact des co-détenus sur la récidive et la formation de réseaux criminels. À partir des données du registre norvégien portant sur plus de 140 000 séjours en prison, les auteurs identifient les effets des pairs de manière causale grâce à la variation intra-pénitentiaire des pairs au fil du temps. Premièrement, l’exposition à des co-détenus plus expérimentés augmente la récidive. Deuxièmement, l’exposition à des « criminels de haut rang » (c’est-à-dire ceux ayant une expérience criminelle extrême) joue un rôle particulier dans la formation de ces schémas de récidive. Troisièmement, les détenus forment des réseaux criminels durables, comme le montre la co-délinquance post-incarcération. Quatrièmement, l’homophilie intensifie ces effets des pairs.
Etudes avec des données nationales
MONNERY, B., « Time to get out ? How sentence reductions affect recidivism after prison », Working paper, November 2016.
Une incarcération plus courte favorise-t-elle une réinsertion réussie ou conduit-elle à la récidive ? Dans cet article, l’auteur propose une nouvelle théorie pour concilier ces deux points de vue concurrents, tous deux fondés sur des bases empiriques et théoriques solides. Son modèle de prise de décision pénale, dépendant des références, intègre la conception concrète des réductions de peine, en termes de timing, d’anticipation et d’adaptation des détenus. Ce modèle a plusieurs implications testables, généralement corroborées par les données. En exploitant une grâce collective accordée en France en juillet 1996, il montre que les réductions de peine ont des effets très différenciés sur la propension des détenus à récidiver, selon leur capacité à anticiper la grâce et leur capacité à s’adapter à la nouvelle avant leur libération, tant psychologiquement que matériellement. Globalement, ces résultats suggèrent que les réductions de peine ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi en termes de récidive, et que les attentes et l’adaptation des détenus sont essentielles.
MONNERY, B., « Surpopulation carcérale : les enjeux d’un mécanisme contraignant de régulation carcérale ». Working paper AFED No 2025-04.
Alors que la population carcérale a atteint un nouveau record historique à 74 513 détenus début juillet 2023, un rapport parlementaire des députées Abadie et Faucillon propose l’introduction progressive jusqu’en 2027 d’un mécanisme de régulation carcérale. Longtemps taboue, l’idée de réguler les flux de personnes détenues pour réduire la surpopulation s’impose de plus en plus comme une nécessité tant le statu quo devient intenable dans nos maisons d’arrêt. Tandis que de nombreux outils promus par le ministère de la Justice ont échoué à résoudre le problème, cet article discute des principaux enjeux de la mise en place rapide d’un mécanisme contraignant de régulation carcérale, pour enfin lutter efficacement contre la surpopulation et prévenir au mieux la récidive.
PHILIPPE, A., « Building Criminal Networks in Prison: Evidence from French Cellmates », Working paper, 23/02/2024.
Cet article examine l’impact des liens avec la prison sur la réincarcération, en utilisant des données complètes sur l’affectation des détenus en cellule en France de 2016 à 2022. Il montre que la présence d’un codétenu supplémentaire condamné pour des infractions liées aux stupéfiants augmente la réincarcération pour des infractions liées aux stupéfiants (+7,2 % dans l’année suivant la libération), tandis que la présence d’un codétenu supplémentaire condamné pour des infractions contre les biens augmente la probabilité d’infractions contre les biens (+5,6 %). Le nombre d’autres codétenus n’a aucun effet, et les autres types de récidive restent inchangés. Les camarades rencontrés en prison influencent également le lieu où les infractions sont finalement commises. Enfin, l’influence des codétenus est plus marquée lorsqu’ils partagent des caractéristiques similaires.