Le suicide en prison
Chaque année, environ 120 détenus se suicident dans les prisons françaises. Le taux de suicide carcéral est environ dix fois plus élevé qu’en population générale, et la situation est particulièrement mauvaise en France par rapport au reste de l’Europe.
Faute d’une diffusion fine de l’information par l’administration pénitentiaire, ce sont les relevés d’associations spécialisées, comme l’Observatoire International des Prisons et Ban Public, qui permettent d’évaluer le nombre de suicides dans chaque établissement, et donc les écarts – particulièrement importants – existant sur le territoire dans les taux de suicide.
Être incarcéré dans certains types d’établissements pénitentiaires peut influer sur le risque de suicide, mais la situation personnelle des détenus apporte également des éléments d’information sur ce phénomène – qui reste toujours difficile à prévoir et à expliquer.
Données générales en France
Le graphique ci-contre présente les statistiques nationales du nombre de détenus décédés par suicide en prison depuis 1995, selon les décomptes de l’Administration Pénitentiaire.
Depuis trois décennies, le nombre de suicides est relativement stable autour d’une moyenne de l’ordre de 110 à 130 suicides par an, mais a atteint 144 en 2023. Les statistiques demeurent légèrement imprécises, notamment car les suicides de détenus en permission ou en aménagement de peine sont comptabilisés certaines années et pas d’autres.
En rapportant le nombre de suicides d’une année au stock moyen de détenus, on peut facilement calculer un taux annuel de suicide pour 1 000 détenus. Il est ainsi d’environ 1,7 suicides pour 1 000 détenus en 2020 – soit en moyenne l’équivalent d’un suicide par an dans un établissement standard d’environ 600 détenus.
Malgré les plans d’action mis en place par l’Administration Pénitentiaire à partir de 2009 (voir la dernière section plus bas), le nombre de suicides ne faiblit donc pas. Le taux de suicide (rapporté au nombre détenus) a lui cependant connu une légère baisse tendancielle depuis 30 ans.
Comparaisons internationales : la France très mal placée en Europe
Le European Prison Observatory propose pour les années 2016 et 2017 une comparaison des taux de suicide en population générale et en prison. Les points bleus du graphique représentent le taux de suicide carcéral (2017) tandis que les points mauves représentent le taux de suicide en population générale (2016).

Partout en Europe, le taux de suicide carcéral est bien supérieur au taux de suicide dans la population générale (exception faite pour le Luxembourg, la Suède et la Croatie d’après ces données).
La France se démarque par le plus haut taux de suicide carcéral en 2017 alors qu’elle n’a pas le plus haut taux de suicide en population générale (Lituanie). Le suicide carcéral est donc un phénomène qui semble particulièrement marqué en France.
Ces chiffres semblent confirmés par les statistiques plus récentes du Conseil de l’Europe (SPACE I) : en 2022, la France indiquait 19,1 suicides pour 10 000 personnes détenues contre une moyenne européenne de 7,1 (soit le troisième taux le plus élevé parmi les 47 pays étudiés).
Nombre de suicides par établissement
L’Administration Pénitentiaire ne publie aucune donnée sur les suicides à l’échelle de chaque établissement pénitentiaire. Pour effectuer un tel suivi, il faut se baser sur les recensions publiées dans la presse locale ou nationale ou sur les signalements reçus par des associations spécialisées. C’est en particulier le cas de Ban Public et de l’OIP, qui mettent à disposition leurs données.
Le graphique ci-dessous montre qu’environ trois quarts des suicides enregistrés par l’Administration Pénitentiaire remontent auprès de ces deux associations (soit environ 80-90 suicides par an), ce qui permet ensuite d’identifier l’établissement concerné et donc de produire des statistiques locales. Pour le quart restant, on ne peut identifier l’établissement en question. À noter que nous ne disposons pas des données de l’OIP pour les années 2020 et 2022.
Cartographie des prisons selon leur taux de suicide
Grâce aux données de Ban Public et de l'OIP, nous pouvons calculer des taux de suicides annuels pour 1 000 détenus pour chaque établissement pénitentiaire - taux qui sont sous-évalués (de l'ordre de 20 % à 30 %) du fait de relevés incomplets.
Sur la période 2014-2019, la très grande majorité des prisons a connu des suicides de détenus et présente donc un taux supérieur à zéro. Les établissements en vert sont ceux pour lesquels aucun suicide n'a été détecté sur la période.
Certains établissements connaissent des taux de suicides annuels supérieurs à 3 pour 1 000 détenus : c'est par exemple le cas de grands établissements comme Bordeaux-Gradignan ou Nice, qui ont chacun connu au moins 12 suicides sur la période de 6 ans étudiée.
Taux de suicide selon le type d'établissement
Le tableau suivant présente le taux de suicide annuel par type d'établissement (toujours pour 1 000 détenus). Le taux de suicide est le plus élevé dans les Maisons d'Arrêt (avec 1,35 suicides identifiés pour 1 000 détenus en moyenne chaque année), soit près de deux fois plus qu'en Maison Centrale, en Centre de Détention ou en Etablissement Pour Mineurs. Rappelons que ces taux sont sous-évalués puisqu'ils se basent sur les relevés incomplets des associations.
À la recherche des déterminants du taux de suicide
Les facteurs individuels du passage à l'acte
Dans leur article "Suicide des personnes écrouées en France : évolution et facteurs de risque" (2014), DUTHE, HAZARD et KENSEY exploitent les données individuelles sur les détenus collectées par l'Administration Pénitentiaire entre 2006 et 2009 pour tenter de mieux comprendre ce phénomène. Les auteurs montrent que le taux de suicide des détenus est particulièrement élevé chez ceux condamnés pour les faits les plus graves (meurtres, viols, agressions sexuelles).
Les résultats statistiques confirment aussi un constat bien connu : les prévenus se suicident proportionnellement deux à trois fois plus que les détenus condamnés. L'étude souligne également l'importance des liens sociaux avec l'extérieur pour prévenir les comportements suicidaires.
Par ailleurs, près de 15 % des suicides interviennent lors d'un placement au Quartier Disciplinaire (QD). En 2023, cela concernait 23 suicides sur 144. Les périodes de QD correspondent ainsi à un risque de suicide multiplié par 15 par rapport au reste de la détention.
Les détenues femmes se suicident également pratiquement autant que les hommes, alors qu'à l'extérieur le taux de suicide varie presque de 1 à 4 entre femmes et hommes.
De nombreuses autres pistes d'explication sont analysées par l'épidémiologiste Alexis VANHAESEBROUCK et relatées dans cette interview par l'OIP.
Analyse économétrique du taux de suicide par établissement
Régression linéaire sur les données de suicides issues des recensements de l'OIP et Ban Public, période 2014-2019
| Y = Taux de suicide annuel moyen pour 1000 détenus | Coefficient | t-stat | p-valeur |
|---|---|---|---|
| Maison d'Arrêt | 0,980 | 2,44 | 0,02 |
| Centre Pénitentiaire | 1,150 | 2,84 | 0,01 |
| Centre de Détention | 0,480 | 1,08 | 0,28 |
| Réf : Maison Centrale, EPM, CSL | |||
| Nb détenus (en log) | −0,080 | −0,52 | 0,60 |
| Surpopulation | 0,000 | 0,13 | 0,90 |
| Construction avant 1990 | 0,290 | 0,93 | 0,35 |
| Construction 1990 - 1989 | −0,090 | −0,28 | 0,78 |
| Construction après 1990 | - | ||
| Distance en KM à la préfecture | 0,000 | −1,25 | 0,21 |
| Condamnation TA/CEDH | 0,240 | 0,82 | 0,41 |
| Présence d'UVF ou de salons familiaux | −0,270 | −0,92 | 0,36 |
| Ateliers en m2 par détenu, en log | 0,210 | 1,16 | 0,25 |
| Constante | 0,650 | 0,96 | 0,34 |
Pour tester d'éventuels facteurs explicatifs relatifs aux établissements pénitentiaires et aux conditions de détention, nous estimons un modèle économétrique du taux de suicide composé des principales caractéristiques des prisons françaises : le type d'établissement, le nombre de détenus et le taux de surpopulation, la date de construction, l'isolement géographique, l'accès au travail en ateliers ou à des unités de vie familiale et autres salons familiaux, ou encore les éventuelles condamnations d'une prison par la justice française ou européenne.
De manière surprenante, aucune des variables explicatives testées n'est corrélée de manière significative avec le taux de suicide constaté dans les prisons françaises sur la période 2014-2019 : les p-valeurs sont toujours nettement supérieures au seuil de 10 %.
Le seul déterminant significatif du taux de suicide à l'échelle d'une prison correspond au type d'établissement : toutes choses égales par ailleurs, les suicides sont plus fréquents d'environ 1 suicide pour 1 000 détenus par an dans les Centres Pénitentiaires et les Maisons d'Arrêt, par rapport aux Maisons Centrales, Etablissements pour Mineurs et Centres de Semi-Liberté.
Le coefficient de détermination de la régression est faible (R2 = 0,13), ce qui montre à quel point les suicides sont un phénomène difficile à expliquer et prévoir à l'échelle des établissements. Nos résultats peu concluants peuvent aussi partiellement s'expliquer par des erreurs de mesure sur les taux de suicides (compte tenu des recensements incomplets).
Les caractéristiques individuelles des détenus permettraient probablement d'apporter des explications plus solides, si nous disposions de données individuelles. C'est ce type d'analyses que DUTHE, HAZARD et KENSEY avaient pu mener, sur des données désormais très datées (2006-2009).
Des dispositifs de prévention face au suicide et à sa récidive
Une identification des personnes à risque
L’identification des situations et moments aggravant le risque suicidaire est un enjeu majeur pour prévenir toute tentative. D'après une étude de Santé publique France, 44 % des détenus morts par suicide présentaient un risque suicidaire repéré par l'administration pénitentiaire ; 64 % présentaient des troubles psychiatriques, et 60 % avaient consulté l’unité sanitaire la semaine précédente.
Avant même le début de l’incarcération, le magistrat en charge du dossier doit remplir une notice individuelle mentionnant si des facteurs de risque suicidaire sont d’ores et déjà identifiés. Arrivé dans l’établissement pénitentiaire, le détenu fait un séjour au Quartier Arrivant (QA), dans lequel est notamment réalisé un entretien médical, ainsi qu’une évaluation du risque suicidaire. Pendant le reste de la détention, l’essentiel des mesures de prévention est décidé lors des commissions pluridisciplinaires uniques « Prévention du suicide » qui se tiennent deux fois par mois. Le personnel pénitentiaires et les autres intervenants en détention échangent alors afin d’adapter leur réponse en cas de situation qu’ils jugeraient inquiétante.
Les principales mesures pour limiter le passage à l’acte
En 2009, le gouvernement met en œuvre un plan d'action de prévention des suicides en milieu carcéral. Ce plan a notamment permis d’assurer une formation des surveillants afin de mieux repérer les signes suicidaires auprès des détenus ou encore d'aménager des cellules de protection d'urgence.
Pour les détenus présentant des risques importants, une « surveillance spéciale » peut être mise en place. Des rondes de sécurité plus fréquentes sont alors réalisées, afin de s’assurer de l’état de santé du détenu.
Dans les cas les plus critiques, le détenu à risque peut être placé dans une cellule de protection d'urgence (CProU). Le mobilier y est scellé au sol, la cellule ne comporte pas de point d’accroche, et les matériaux sont ignifugés. Un kit composé de vêtements et couverture déchirables est aussi distribué (la pendaison représentant 90 % des cas de suicides en détention). Si la crise suicidaire persiste au-delà de 24h après l’entrée en cellule d'urgence, le détenu peut être admis en unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) ou bien à l’unité sanitaire de son établissement.
De nouveaux dispositifs en collaboration avec d’autres acteurs
Le dispositif des Codétenus de Soutien (CDS) est en expérimentation suite au plan d’action de 2009. Une quinzaine de prisons en bénéficie actuellement. Lorsqu’un détenu est repéré comme présentant des risques suicidaires, un CDS, préalablement formé par la Croix-Rouge, lui est attribué afin de lui apporter un soutien psychologique. La responsabilité morale du CDS est cependant assez lourde comme expliqué dans cet article de l'OIP.


Créé en 2015 à destination du grand public, VigilanS est un dispositif de recontact et d’alerte conçu pour accompagner les individus ayant fait une tentative de suicide. L’expérimentation en milieu carcéral a démarré en 2021. Depuis déployé dans une dizaine d’établissements, VigilanS permet à des détenus de recevoir des cartes postales individualisées, manuscrites et demandant aux détenus de leurs nouvelles. En cas de réponse, une correspondance écrite peut s’engager. Si des propos inquiétants sont relevés, l’unité sanitaire de l’établissement pénitentiaire est alors prévenue.
Suite à la signature par le Gouvernement et d’autre acteurs d’un contrat à impact social, Médecins du Monde pilote depuis 2021 le dispositif « Alternative à l’Incarcération par le Logement et le Suivi Intensif », qui permet d’éviter la détention provisoire en comparution immédiate à des personnes sans abri souffrant de troubles psychiatriques. En ciblant des profils très fragiles, ce dispositif cherche à éviter aux bénéficiaires le parcours « prison – rue – hébergement – hôpital », associé à des risques suicidaires importants.
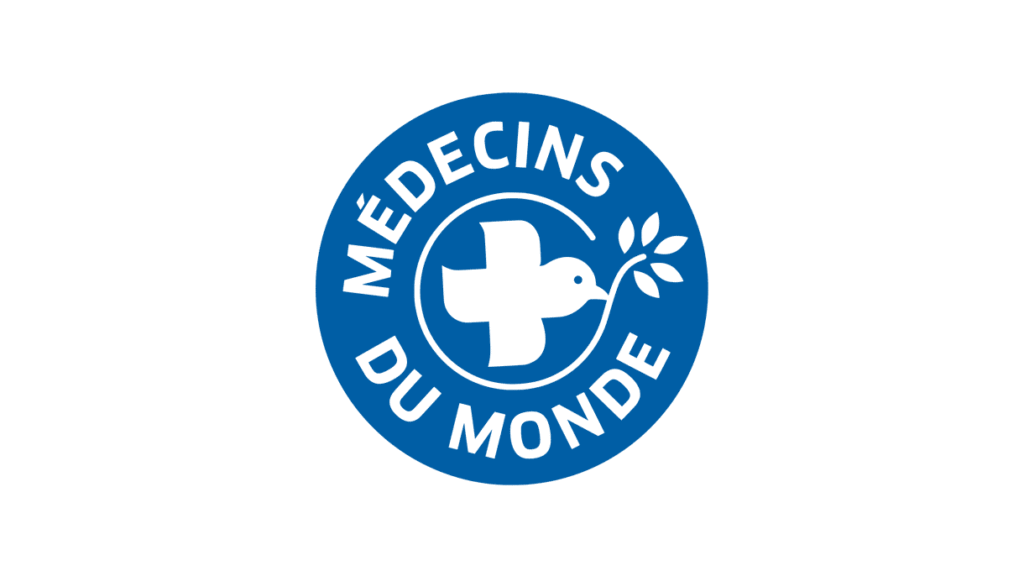
Pour aller plus loin
En France
DUTHE, G., HAZARD, A. & KENSEY, A., "Suicide des personnes écrouées en France : évolution et facteurs de risque", Population, vol. 69, 2014, pp. 519-549.
L’univers carcéral est-il propice au suicide ? L’est-il davantage aujourd’hui ? Dans un article de Population paru il y a près de 40 ans, Jean-Claude Chesnais établissait pour la France une nette sursuicidité des personnes détenues par rapport à la population libre. À partir des données administratives de la direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice, Géraldine Duthé, Angélique Hazard et Annie Kensey mettent à leur tour en évidence la sursuicidité de la population masculine écrouée par rapport à la population générale. Tandis que les taux de suicide ont relativement peu varié au cours du temps dans la population générale, ils n’ont cessé d’augmenter en prison et y sont aujourd’hui sept fois plus fréquents qu’en milieu libre. Analysant le suicide des personnes écrouées entre 2006 et 2009, les auteurs identifient les principaux facteurs de risque liés à la condition carcérale.
Direction de l'administration pénitentiaire, "Fiche 8 - Chez les détenus, un taux de suicide en hausse mais de nouveaux dispositifs de prévention", DRESS, 24/02/2025, pp. 229-237.
La prévention du suicide représente une priorité majeure et ancienne pour l’administration pénitentiaire (un plan d’action national a été lancé dès 2009). Malgré cet engagement, l’année 2023 a été marquée par un nombre accru de suicides (+12,9 % entre 2022 et 2023 ; +31,9 % entre 2020 et 2023) qui souligne la nécessité du nouveau plan d’action national et des mesures déployées à l’issue d’une mission d’inspection menée en mai 2021 par l’Inspection générale de la justice (IGJ) et par l’Inspection générale des affaires sociales (Igas). Le taux de suicide – qui passe de 16,0 à 17,5 pour 10 000 détenus entre 2020 et 2023 – augmente toutefois à un rythme moins soutenu, du fait de l’augmentation de la population carcérale. Celle-ci est en effet constatée de façon régulière depuis plusieurs années, et atteint actuellement un record (+4,7 % entre 2022 et 2023 ; +22,7 % entre 2020 et 2023).
A l'étranger
HJALMARSSON, R. & LINDQUIST, M., “The Health Effects of Prison”, CEPR Discussion Papers 15214, 2020.
Cet article étudie l’effet sur la mortalité de deux réformes suédoises des libérations anticipées, mises en place en 1993 et 1999, qui ont maintenu les peines de prison à un niveau constant, mais ont augmenté la durée de la peine de la moitié à deux tiers. Contrairement aux données corrélationnelles précédentes, les auteurs constatent que l’exposition à ces réformes et l’augmentation correspondante de la durée de la peine n’ont pas nui à la santé des détenus après leur libération. Au contraire, le risque global de décès diminue, avec des effets particulièrement importants et significatifs pour les personnes positivement sélectionnées en fonction de leur carrière criminelle et de leur lien avec la société. Ils constatent également (i) une réduction significative et persistante du risque de suicide, (ii) une réduction à court terme des morts violentes et (iii) une amélioration à long terme de l’état de santé général (mortalité circulatoire). Ces effets spécifiques à une cause sont induits par des populations à risque particulières : les personnes présentant des problèmes de santé mentale avant l’incarcération, les délinquants violents et les délinquants âgés, respectivement. Les auteurs soutiennent que ces résultats sont principalement liés à un mécanisme direct de traitement et de services de santé en prison : ils démontrent que le recours aux soins de santé et la participation aux programmes augmentent avec la durée de la peine. Ils constatent également que l’exposition à la réforme diminue la récidive et a des effets bénéfiques à très court terme sur le marché du travail. Leurs principales conclusions, cependant, ne semblent pas être liées à ces changements de mode de vie.
HJALMARSSON, R. & LINDQUIST, M., “The Health Effects of Prison”, American Economic Journal: Applied Economics, American Economic Association, vol. 14(4), October 2022, pp. 234-270.
Cet article étudie les effets sur la santé des réformes pénitentiaires suédoises, qui ont maintenu les peines constantes mais augmenté la durée de la peine purgée. Cette augmentation de la durée de la peine n’a pas eu d’impact négatif sur la santé après la libération et a même réduit le risque de mortalité. Les auteurs constatent une baisse particulièrement importante de la mortalité chez les délinquants n’ayant jamais été incarcérés, les jeunes délinquants et ceux qui sont plus en contact avec le marché du travail. Le risque de suicide et de décès par maladie circulatoire a diminué respectivement chez les détenus souffrant de troubles mentaux et les détenus plus âgés. Le recours aux soins de santé en prison et la participation aux programmes ont augmenté avec la durée de la peine purgée, ce qui suggère que les soins et les services de santé sont le principal mécanisme de baisse de la mortalité.
CAMPANIELLO, N., DIASAKOS, M. & MASTROBUONI, G., “Rationalizable Suicides : Evidence from Changes in Inmates’ Expected lenght of sentence”, Journal of the European Economic Association, vol. 15, Issue 2, 8 April 2017, pp. 388–428.
Existe-t-il une composante rationnelle dans la décision de se suicider ? Les économistes tentent d’éclairer cette question en étudiant si les taux de suicide sont liés aux conditions socio-économiques contemporaines. Cet article va plus loin : nous testons si les suicides sont liés à des comportements prévoyants. En Italie, les réductions de peine collectives (grâces) entraînent souvent des libérations massives de détenus. Plus important encore, elles sont généralement précédées d’une activité parlementaire prolongée (propositions de loi, discussions, votes, etc.) que les détenus semblent suivre de près. Nous utilisons les propositions de loi de grâces collectives pour mesurer l’évolution des attentes des détenus quant à la durée de leur peine, et nous constatons que les taux de suicide tendent à être significativement plus faibles lorsque les grâces sont proposées au Congrès. Cela suggère que, parmi les détenus des prisons italiennes, la décision moyenne de se suicider répond à l’évolution des attentes actuelles quant à leurs conditions futures. Par conséquent, la décision semble, au moins en partie, rationalisable.
Rapport de l’observatoire européen des prisons sur le suicide des détenus
Le rapport traite notamment des chiffres du suicide dans les prisons en Europe et de l’écart du taux de suicide en prison avec celui du taux de suicide en population générale.

