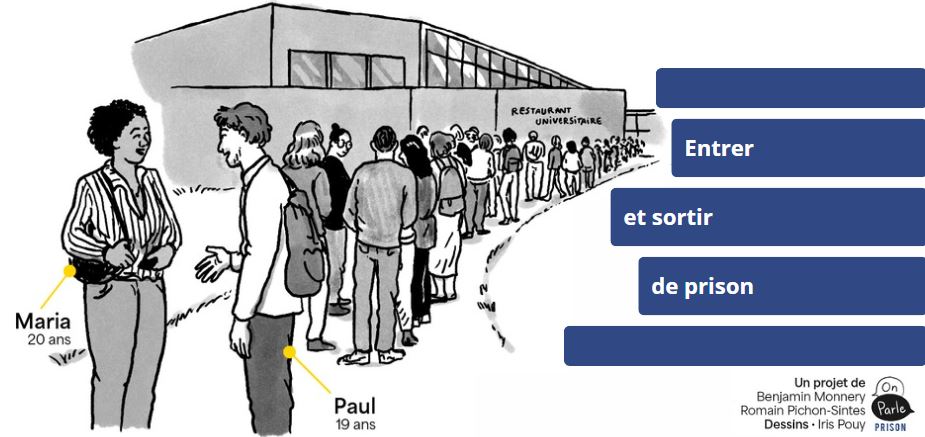Comment évolue la population carcérale en France ?
Aujourd’hui, plus de 70 000 détenus sont incarcérés en France. Ce chiffre a tendance à augmenter sur longue période, essentiellement du fait d’un allongement des durées d’incarcération, et non d’une hausse du flux d’incarcération (quasiment le même qu’il y a 15 ans). Le nombre de détenus incarcérés est toujours supérieur au nombre de places disponibles, hormis lors de courts épisodes très spécifiques (début 2001 ou début 2020 pendant la première vague du Covid). Cette surpopulation alimente un cercle vicieux de nouvelles constructions de prisons et de nouvelles incarcérations.
Si 70 000 détenus sont incarcérés en France, ce chiffre exprimé en stock ne doit pas faire oublier l’ampleur du phénomène de l’incarcération lorsqu’il est mesuré en flux : d’après les données de l’Administration Pénitentiaire, environ 150 000 personnes passent par la case prison en France chaque année
Quelles évolutions récentes de la population carcérale ?
- Depuis juin 2020, la population carcérale repart très fortement à la hausse en France, après une baisse exceptionnelle lors de la première vague du Covid-19. Le début de la crise du Covid a en effet marqué une chute historique du nombre de détenus au second trimestre 2020. Sur les mois d’avril à juin 2020, le nombre de détenus a baissé de 13 000 détenus, soit -20% par rapport au niveau du 1er mars 2020. L’explication vient pour moitié du fort ralentissement des entrées en prison et pour l’autre moitié de la forte accélération des libérations. Le 25 mars 2020, le Ministère de la Justice a publié une ordonnance incitant les magistrats à aller dans ce sens, en promouvant les alternatives à l’incarcération et les réductions de peine supplémentaires pour motif sanitaire. Au-delà, l’épidémie a contraint les tribunaux à passer au télétravail et à annuler nombre d’audiences. Cette activité réduite a mécaniquement ralenti le flux d’entrées en détention.
- Mais le rebond de la population carcérale depuis juin 2020 est tout aussi exceptionnel. Un an après le point bas de juin 2020, le nombre de détenus avait déjà augmenté de plus de 8 500 détenus (66 591 détenus au 1er juin 2021). Au 1er juin 2022, la population carcérale dépasse le seuil des 71 500 détenus (+14 000 en 2 ans). Chaque mois depuis ce point bas de juin 2020, la population augmente en moyenne de près de 570 détenus supplémentaires, soit l’équivalent d’un grand Centre Pénitentiaire rempli par mois. En 24 mois seulement, les prisons françaises ont donc déjà rempli toutes les places qui avaient été libérées lors de la première vague de l’épidémie.
- Avant le déclenchement de l’épidémie de Covid, les évolutions de la population carcérales étaient plus lentes. Entre 2015 et 2020, la population carcérale est passée de 66 000 à environ 71 000 détenus début 2020. Cette augmentation très stable pendant 5 ans correspond à une hausse d’environ 1 000 détenus par an. Plusieurs facteurs sont susceptibles d’expliquer le phénomène, comme l’augmentation de certains types de criminalité : les vols ou encore les violences sexuelles ont par exemple augmenté sur la période. Mais la hausse du stock de détenus est d’abord expliquée par une augmentation sensible des durées d’incarcération, le flux d’entrées étant assez stable sur longue période.
La baisse des incarcérations en 2020 s’explique aussi par une diminution de certains types de délinquance. Les graphiques ci-contre, réalisés par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), montrent l’évolution annuelle du nombre d’infractions constatées en France pour des faits de vols, et témoignent d’une rupture dans la délinquance.
Les vols sans violence ont brutalement baissé de -24% en 2020 (-172 000 victimes par rapport à 2019), en rupture avec plus d’une décennie de hausse ou de plateau haut. Les vols dans les véhicules ont aussi chuté de 17% en un an. Ces fortes baisses de certaines délinquances peuvent être attribuées aux confinements liés au Covid-19.
Quels sont les flux d’entrées et de sorties en détention ?
Découvrez la gestion des flux d’entrées et de sorties en détention de façon interactive et illustrée, en suivant Maria et Paul dans notre épisode dédié de “On Parle Prison” !
Le nombre de placements en détention et de libérations varie généralement entre 70 000 et 80 000 par an depuis 2006. Ces flux annuels sont massifs puisqu’ils correspondent grosso modo au stock de détenus à une date donnée (de l’ordre de 70 000 personnes ces dernières années), comme si la population carcérale était totalement renouvelée chaque année. De 2006 à 2019, il y a eu un peu plus d’un million d’entrées en détention en France, et presque autant de sorties.
- Le nombre de personnes qui passent par la case prison sur une période de quelques années est donc beaucoup plus élevé que le nombre de personnes détenues à une date donnée. Entre janvier 2016 et décembre 2017 par exemple, 231 500 personnes sont passées par la case prison d’après les données de Genesis (le logiciel de gestion de l’Administration Pénitentiaire), soit l’équivalent de la population de Bordeaux. Et chaque année, près de 150 000 personnes passent au moins un jour en prison.
- La comparaison des flux d’entrées (F) et du stock de détenus (S) permet aussi de calculer un indicateur de durée moyenne d’incarcération, calculé comme d = (S / F) x 12. Depuis 2010, cet indicateur varie entre 9 et 11 mois, contre 7 mois en 2006 par exemple.
- Ces indicateurs de durées moyennes cachent en réalité d’énormes écarts, entre des dizaines de milliers d’incarcérations très courtes (de l’ordre de 3 ou 6 mois) et une minorité de détenus purgeant des peines longues ou très longues. En 2021, 30% des libérations correspondent à des personnes ayant passé moins de 3 moins sous écrou ; seuls 18% des sorties concernent des personnes ayant passé plus d’un an sous écrou.
Des prisons de taille très variable
Quels liens entre population carcérale et capacité des prisons ?
- Structurellement, le nombre de places de prison est très inférieur au nombre de détenus en France. Entre 2000 et 2020, cet écart a été de l'ordre de 10 000 détenus en trop par rapport à la capacité opérationnelle des prisons françaises. Depuis la fin du Covid-19, le décalage est encore plus grand et atteint 17 000 détenus en trop.
- La surpopulation carcérale est reconnue comme un problème majeur du système pénal français depuis plusieurs décennies, mais la situation persiste. De 1990 à début 2020, la France a connu un seul court épisode de sous-population : au 1er janvier 2001, il y avait légèrement plus de places que de détenus.
- Conjoncturellement, la population carcérale évolue plus que la capacité : le nombre de détenus peut évoluer assez sensiblement d'une année à l'autre, voire d'un trimestre à l'autre, en fonction des réformes de politique pénale (années 2002-2004 par exemple) ou de mesures d'exception (amnisties, grâces collectives, crise du Covid, etc.). A l'inverse, la capacité opérationnelle des établissements évolue essentiellement sur le moyen-long terme au gré des ouvertures et fermetures d'établissements pénitentiaires (et plus marginalement au gré des travaux dans des bâtiments ou cellules du parc existant). Le capacité opérationnelle ne peut donc pas s'adapter à court terme : la seule solution d'urgence pour les chefs d'établissement consiste à ajouter des lits ou des matelas au sol, et à effectuer des transferts entre établissements voisins.
- Il est à noter que la surpopulation touche essentiellement les Maisons d'Arrêt, les établissements pour peine (CD et MC) fonctionnant sous une règle de numerus clausus.
Un cercle vicieux "Constructions <-> Incarcérations" ?
Entre janvier 1990 et janvier 2020, le parc pénitentiaire a gagné environ 25 000 places ; mais la population carcérale a elle-aussi augmenté de 25 000 détenus. Le problème de surpopulation n'a donc guère évolué en 30 ans. C'est ce constat qui fait dire à certains que "plus on construit, plus on incarcère", quand d'autres répliquent que "plus on incarcère, plus on construit". Les deux interprétations ont leur part de vérité :
- d'un côté, le Ministère de la Justice et son agence immobilière (l'APIJ) tentent d'adapter leurs plans de construction et de fermeture d'établissements aux besoins constatés et prévisibles à moyen terme ;
- de l'autre, il est possible que les magistrats dans les juridictions comme l'administration centrale du Ministère adaptent leurs décisions à la surpopulation (en matière de peines prononcées, de réductions de peine et d'aménagements, de projets de réformes pénales, etc.) pour éviter d'aggraver encore la situation des prisons françaises. A l'inverse, l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires peut créer une forme d'appel d'air pour plus d'incarcérations dans les tribunaux voisins.
Pour distinguer ces deux effets, Arnaud Philippe a comparé dans son livre ("La fabrique des jugements", Ed. La Découverte, p. 173) les peines prononcées et les niveaux de surpopulation dans les départements qui avaient connu, en 2009 et 2010, des ouvertures de prison à ceux qui n'en avaient pas connu. Son analyse statistique montre un effet bénéfique durable de l'ouverture d'un établissement sur le taux de surpopulation carcérale, qui reste près de 20% inférieur à son niveau antérieur. Au contraire, aucun effet n'est observé sur les peines prononcées par les tribunaux locaux suite à l'ouverture d'un établissement. Ces résultats relativisent la menace d'un effet d'appel d'air, selon lequel toute ouverture de prison ne ferait que générer de nouvelles incarcérations.
Pour aller plus loin
En France
Le bilan statistique de la délinquance en France en 2020 est produite par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Il fait le point sur les évolutions très notables de la délinquance constatées pendant cette année d'épidémie.
Ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédures pénales
Le texte de l'ordonnance du 25 mars modifie de nombreuses règles de procédures pénales pour s'adapter aux conditions sanitaires dans les juridictions et accélérer les libérations de détenus proches de leur fin de peine.
La fabrique des jugements, 2022, Arnaud Philippe, Ed. La Découverte
Voir notamment le chapitre "L'intendance suivra", pp .163-190.